Colloque lors de l'exposition " Générations" dans le cadre de la nuit des idées 2018 (Captation vidéo)
« L’Imagination au pouvoir » ou : Comment advient une forme ? Cette question est au cœur du travail de Rachel Poignant. Depuis ses toutes premières sculptures, l’artiste a développé des processus et des méthodes lui permettant de déléguer son pouvoir d’imagination aux matériaux qu’elle emploie.
Construction, processus, vérité des matériaux, informe… Les catégories les plus pertinentes de l’histoire de l’art semblent parfois sans prise sur des objets sans nom. C’est ce qui se passe avec Rachel Poignant. Et cela, à soi seul, justifie l’idée d’une soirée d’étude. Comment en parler ?
Que les objets soient ici les traces d’une activité est un fait d’évidence. Mais l’activité ne se présente pas pour autant en tant que telle, pour elle-même. Un choix de matériaux et des procédures ont fini par constituer une méthode. Une collection et un corpus, aux limites floues, se sont constitués, par dépôts successifs. Des séries et des singularités se sont mises en place. Toutefois, l’artiste semble répondre à une étrange compulsion. Comme s’il lui fallait constamment retarder l’arrivée de la forme, en donnant toute leur chance à des formes multiples.
Modérateur : Jean François Chevrier ( historien de l’art, critique d’art, commissaire d’exposition)
Participants : le poète et éditeur Benoit Casas ( Editions Nous), la docteur Bénédicte Duvernay (Université de Rennes, département des arts plastiques), l’artiste et écrivain Adrien Malcor, la directrice du Musée national de Krolikarnia Agnieszka Tarasiuk et l'artiste plasticienne Rachel Poignant.
Jean François Chevrier
« Je propose deux citations de deux poètes. La première, de Stéphane Mallarmé :
La Nature a lieu, on n’y ajoutera pas ; que des cités, les voies ferrées et plusieurs inventions formant notre matériel.
Tout l’acte disponible, à jamais et seulement, reste de saisir les rapports, entre temps, rares ou multipliés ; d’après quelque état intérieur et que l’on veuille à son gré étendre, simplifier le monde.
À l’égal de créer : la notion d’un objet, échappant, qui fait défaut.
Semblable occupation suffit, comparer les aspects et leur nombre tel qu’il frôle notre négligence : y éveillant, pour décor, l’ambiguïté de quelques figures belles, aux intersections 1.
« La Nature a lieu, on n’y ajoutera pas »… Selon les individus, selon les subjectivités, selon les orientations spécifiques prises par tel ou tel artiste, le travail sur les rapports entre les choses ira, dit Mallarmé, dans le sens d’étendre ou simplifier le monde. L’être humain peut fabriquer des choses mais il n’intervient qu’au sein du monde existant, qu’il transforme, sans rien y ajouter. On va continuer à construire, on fabrique des choses, mais ça ne touche pas à la nature qui existe, qui est complète et qui ne demande rien. En agissant sur les relations, ou « rapports » entre les choses, l’être humain peut tout au plus transformer des matières premières en « matériel ».
Si l’on considère la première salle de l’exposition, on peut considérer que Rachel ajoute beaucoup… En réalité, toutes ces choses rassemblées forment un « matériel » (obtenu à partir d’une transformation de matériaux) plus qu’un corpus, plus qu’un ensemble d’œuvres constituées. Rachel s’inscrit dans une logique dite « conceptuelle » ou « post-minimale ». Mais, en s’intéressant au moule et au moulage, elle est remontée des formes à la formation, et cela à la manière de Paul Klee plutôt qu’à celle des artistes conceptuels. Au fond, le moule est à la fois une forme vide et une forme formatrice. Rachel se défie des formes arrêtées, fixées, définies. Au cours de nos discussions, elle a insisté sur ce point. Je l’ai entendue dire par exemple : « Je ne parle pas beaucoup de forme, je parle de pièces, d’objets. Dès le début du travail de moulage, il s’agissait de ne pas avoir à décider d’une forme. Faire une forme est prétentieux. J’accorde plus d’intérêt au parcours qui part d’un geste. »

Rachel considère, comme d’autres avant elle, que le monde est encombré de choses, d’artefacts. Douglas Huebler, par exemple, considérait qu’il fallait substituer le modèle à l’objet. Je ne sais pas si cette distinction fait quelque sens pour Rachel ; je ne me rappelle pas que nous en ayons parlé. Le modèle, au sens de la modélisation d’une expérience, c’est peut-être chez elle le moulage. Si le moule suppose l’espace creux, négatif, d’une matrice, son corollaire est l’objet « échappant, qui fait défaut » de Mallarmé, mais aussi l’objet en moins mise en œuvre naguère par Michelangelo Pistoletto.
Un objet « en moins », c’est un objet qui n’est plus à faire. C’est une chose de moins à faire. Une façon, donc, de limiter la production d’objets à l’invention d’exemplaires uniques : uniques et quelconques, sans affirmation distinctive. Toutefois, Rachel Poignant s’est plutôt inspirée de « l’infra-mince » de Duchamp : moins et plus jouent chez elle dans le rapport du vide au plein, du creux ou relief. L’activité est sans projet, mais elle est régie par le principe du moulage qui tend à annuler la distinction entre positif et négatif (c’est-à-dire, en l’occurrence, entre ce qui moule et ce qui est moulé). Faut-il peut parler d’un travail du négatif, comme chez Mallarmé ? Le principe du moulage correspond à une logique de formation matricielle qui intègre le négatif, puisqu’il le fait apparaître à l’égal de la forme positive. On revient toujours au moule comme forme formatrice.
Au vu de l’installation actuelle dans la première salle de l’exposition, on pense à un dépôt d’expérience (et d’expérimentation). On perçoit des familles de formes et de matériaux. L’œil circule, s’arrête, repart. Je ne sais pas si l’on peut vraiment parler d’« intersections », au sens où l’entend Mallarmé. On perçoit des vitesses différentes, variables, plus que des lignes ou des orientations. En tout cas, les procédés de fabrication ne sont pas mis en avant pour eux-mêmes. On ne pense pas à des « processus » ni à des « procédures » ; ces deux termes sont heureusement inadéquats et inutilisables. Le travail n’est pas surexposé. Les objets – puisqu’il y a tout de même « objets » – ne forment pas un répertoire ni, a fortiori, un catalogue. En revanche, on peut penser « collection ». On reconnaît même des ballons et des dés (variantes de la boule et du cube). Ce qui indique, bien sûr, la dimension du jeu. La photographie au mur des petites chaises associe le jeu à l’enfance.

J’emprunte la seconde citation au seizième et dernier chapitre de La Quatrième prose (1930) d’Ossip Mandelstam :
J’aurai beau me crever au travail, porter des chevaux sur les épaules, faire tourner les meules des moulins, de toute façon, je ne serai jamais un travailleur. Mon travail, quelque forme qu’il puisse prendre, il n’est perçu que comme pur caprice, espièglerie, hasard. Mais telle est bien ma volonté, j’accepte. Je signe des deux mains.
Deux façons de voir les choses : pour moi, dans le pain couronne, ce qui compte, c’est le trou. Et la pâte de la couronne ? La couronne, on la mange — le trou, il reste.
Le travail authentique — c’est une dentelle de Bruges. Ce qui compte dedans, c’est ce qui tient le motif : l’air, les vides, les ajours 2.
Il me semble que cette citation correspond au grand mur de la quatrième salle.

Je n’ai pas de citation pour la cinquième et dernière salle, magnifique, de l’exposition. Ni pour la petite pièce blanche accrochée dans la rotonde.

L’exposition suit une progression chronologique. Mais il y a un tournant, difficile, dans la troisième salle. J’espère que nous aurons l’occasion d’en parler. J’aimerais entendre Rachel et Agnieszka qui l’ont conçue. Je remarque le surgissement d’une dimension « métaphysique », au sens où l’entendait Giorgio de Chirico. C’est particulièrement sensible quand on regarde le centre de la plateforme en direction de la fenêtre qui donne sur le parc. Les objets prennent une nouvelle stature. Les trois tables constituent de toute évidence une rupture d’échelle autant qu’un effet de rehaussement du plan visuel constitué par la plateforme mise en place dans la première salle. Je suppose que l’apparition du mur comme plan-support vertical dans la quatrième salle est censée procéder de cette nouvelle stature des objets.

1Stéphane Mallarmé, La Musique et les Lettres, 1895 ; Œuvres complètes, t. II, éd. Bertrand Marchal, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 67-68.
2Ossip Mandelstam, La Quatrième prose (1930), trad. André Markowicz, Paris, Christian Bourgois, 1993, p. 41.
Benoit Casas
Travaux d'approche
Je voudrais d’abord remercier
Agnieszka Tarasiuk et Krollikarnia de cette invitation.
Je dois aussi préciser que mon intervention aujourd’hui
devait être sous forme de dialogue avec Anka Ptaszkowska.
Finalement Anka n’a malheureusement pas pu se joindre à nous.
Je ne parlerai bien sûr pas à sa place, je vous transmettrai juste
deux éléments qu’Anka aurait souhaité développer lors
de ce dialogue.
Je voudrais dire également que je suis très heureux de participer
à cette journée d’études autour du travail de Rachel Poignant.
C’est un travail qui m’a toujours profondément intéressé
et quand je dis ‘toujours’ ce n’est pas un abus de langage
puisque c’est un travail que j’ai vu naître, peu à peu, lors
de nos études communes aux beaux-arts de Caen
dans les années 1990, et dans les expositions qui ont suivi,
notamment une à Cracovie en 1996. Déjà la Pologne donc
et déjà l’amitié et l’échange avec Anka Ptaszkowska.
Je précise aussi que j’ai écrit le texte de cette intervention avant
d’avoir vu l’exposition, assez impressionnante,
et que je parlerai du travail de Rachel Poignant
en général, je parlerai surtout de ses enjeux ,et je ne prendrai pas le temps de
m’arrêter sur des exemples de pièces.
Je dirai enfin, à titre informatif mais significatif,
avant d’en venir à mon propos,
que les éditions Nous, que je codirige, ont le projet d’éditer
une monographie consacrée au travail de Rachel Poignant.
Mon intervention s’intitule : Travaux d’approche.
Travaux d’approche : 2 raisons pour ce titre, repris de Michel Butor,
il désigne d’un même geste une tentative
pour me rapporter au travail de Rachel Poignant
Travaux d’approche, c’est-à-dire
non pas une idée développée et précisée
mais une pluralité de propositions
pour tenter de cerner, d’approcher donc,
un territoire d’œuvres lui-même
assez multiple.
Mais le titre veut également nommer le travail
de Rachel lui-même avec l’intuition
que son parcours et les objets qui en résultent
ne sont pas l’expression d’une affirmation stylistique
ni théorique, ni même celle d’un medium
mais bien plutôt la résultante d’un réseau de gestes,
d’une attention à ce qui arrive et d’une tension
vers ce qui n’est pas encore là et vers quoi
il faut tendre.
C’est cette multiplicité de gestes et de regards,
confrontés à des matériaux, produisant des objets
à la fois conséquences et porteurs d’un temps assez
particulier, que je vais interroger, en vitesse,
sous différents angles.
Soit, en une formule d’insistance :
une tentative, la mienne : travaux d’approche
de travaux d’approche : les siens.
Nous avions décidé avec Anka de partir de l’énoncé général
sous lequel s’inscrit l’exposition de Rachel :
L’imagination au pouvoir
Et nous avions décidé de procéder ensemble et à tour de rôle
à une sorte de renversement intégral de ce titre
et de dire que ce dont il s’agit en vérité dans le travail de Rachel
ce n’est ni d’imagination, ni de pouvoir.
Anka avait proposé une répartition dans laquelle
elle aurait pris en charge la question de l’imagination
et de sa critique radicale, et moi la question du pouvoir
et du refus ou de la distance à cette question du pouvoir
dans lesquels se place selon nous le travail de Rachel.
Anka n’est pas là et je ne pourrai pas vous développer
ce qu’elle voulait vous dire mais je peux quand même
vous transmettre 2 pistes qu’elle aurait évoqué :
d’une part une lecture du Manet de Bataille
où celui-ci voit dans ce qu’on pourrait nommer
le décapage littéraliste une sévère critique en acte
de l’imagination, critique qu’on trouverait finalement à l’œuvre
dans l’art moderne en général.
D’autre part Anka aurait parlé du lien entre imagination
et illusion. C’est une piste que je trouve très excitante
mais je ne sais pas exactement ce qu’Anka aurait
développé à ce propos.
De mon côté, concernant cette histoire d’imagination
je vais quand même proposer 1 ponctuation, sans doute
complémentaire de celles d’Anka, avant d’en venir
cette fois-ci tout à fait directement à ce que serait
cet envers de l’imagination à l’œuvre dans le travail
de Rachel.
Cette ponctuation, c’est un mot d’ordre et on le trouve,
c’est peut-être paradoxal, chez Henri Michaux
Ce mot d’ordre de Michaux c’est : « N’imaginez jamais ! »
J’y pense souvent, et j’y ai pensé notamment, fortement,
au moment de la polémique entre Gérard Wajcman
et Georges Didi-Huberman, au début des années 2000,
sur la question des images d’Auschwitz.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette polémique, j’évoquerai
juste un point : Didi-Huberman écrit dans Images malgré tout,
c’est la deuxième phrase du livre : « il faut imaginer Auschwitz ».
Je trouve cette affirmation désastreuse.
Non, il ne faut pas imaginer Auschwitz, il faut
lire, il faut s’instruire, il faut écouter.
Les survivants, les historiens, les témoignages.
Bref, « N’imaginez jamais ! »
J’en viens au travail de Rachel.
S’il ne s’agit pas d’imagination ici, et il ne s’agit pas d’imagination,
de quoi s’agit-il ? Il s’agit de réel, le réel, l’épreuve du réel,
et même du réel comme nom de l’impossible
pour reprendre les catégories de Lacan.
Quelque chose qui s’éprouve,
quelque chose qui insiste,
quelque chose qui ne se contourne pas,
qui ne s’évite pas.
Donc, pas l’imagination : le réel.
Mais il ne s’agit pas pour autant de dire : « Le réel au pouvoir »
Le deuxième terme est également à contester
Ou plutôt : le travail de Rachel atteste de cette contestation.
Il atteste de cette contestation même si ce n’est pas
sur un mode critique mais de manière affirmative.
Le travail de Rachel est la négation même de l’idée d’une prise de pouvoir
qu’il s’agisse d’un côté de son rapport au monde de l’art,
de l’autre de son rapport au matériau.
Le rapport au matériau n’est pas du côté de la recherche de maîtrise
ou d’une domination sur le matériau,
il s’agit bien plus d’une attention portée à la façon dont le matériau
réagit, déborde, cristallise, se colore.
D’une attention à l’accident, à l’imprévu.
Il s’agit d’une sorte d’attention à ce qui arrive, d’attention généralisée
ou bien, pour reprendre une expression proposée par des jeunes gens
pour définir ce que pourrait être un nouveau communisme :
d’une « discipline de l’attention ».
Cette « discipline de l’attention » nomme bien je trouve l’attitude de Rachel.
Quand à la distance au monde de l’art peut-être est-ce tout simplement
que Rachel n’a pas le temps de se préoccuper de cela,
Rachel est au service de son activité
elle est toute à son faire, à ce qui compte vraiment pour elle.
En cela je dirais volontiers que son travail atteste véritablement d’une éthique.
Ethique au sens que lui donne Wittgenstein dans sa Conférence sur L’éthique
dans laquelle il définit celle-ci de la manière suivante :
« L’éthique est l’investigation de ce qui compte réellement »
Si nous avons opposé réel à imagination
nous pouvons maintenant, pour renverser intégralement la formule,
opposer puissance à pouvoir.
Puissance du faire, puissance du processus.
Le processus comme puissance d’engendrement.
Et on entend que cette puissance d’engendrement consonne
avec le titre de l’exposition « Générations ».
Puissance d’engendrement donc mais aussi
modalités d’un faire sans pouvoir
où s’atteste la force d’une continuité.
Mais il s’agit d’un double mouvement
car si le travail établit une sorte de souveraineté du faire
cette souveraineté n’est pas sans conséquence
car il s’agit aussi, dans le même temps,
d’une épreuve de la dépossession d’une part,
d’une désauratisation de l’artiste d’autre part.
Concernant la dépossession on peut rappeler, très factuellement,
qu’une partie importante des pièces de Rachel n’existe plus,
si ce n’est sous forme mémorielle ou photographique,
que la dépossession a pris pour part la forme d’une destruction,
destruction due au caractère périssable de certains matériaux
utilisés par Rachel à certains moments de son parcours.
Primat du faire et désauratisation de l’artiste
le travail de Rachel est du côté de l’acte,
d’une insistance de l’acte.
Cette puissance du processus
cette force de continuité
cette insistance de l’acte
sont producteurs d’objets
il ne faut pas non plus l’oublier.
Premier constat concernant les pièces : le nombre
le grand nombre des pièces.
Un processus ponctué de pièces.
J’aurais envie de dire :
un peuple de pièces
un peuple d’objets.
La première salle de l’exposition en atteste de façon
assez saisissante je trouve.
Un peuple où, autre mot pour nommer le nombre :
une collection. Une collection d’objets, une collection de pièces
avec, et on retrouve là l’idée d’approche,
cette caractéristique de la collection, mise en lumière par Gérard Wajcman
dans un remarquable petit livre intitulé Collection,
qui est que l’objet le plus important de la collection,
pour celui-celle qui le cherche
est l’objet qui manque, le prochain.
L’incomplétude est la caractéristique première de la collection.
L’objet produit, la nouvelle pièce importe bien sûr
comme présence matérielle tangible
et distincte des pièces qui précèdent
mais également, comme porteuse d’un autre possible
qu’elle n’exprime pas elle-même.
Le travail doit donc se poursuivre
et importe finalement plus pour Rachel j’ai l’impression,
en tant cas de façon à la fois plus urgente
et plus intrinsèque, que la monstration du déjà fait.
Des pièces nombreuses donc,
mais distinctes, uniques.
chaque pièce a son existence
avec une grande diversité de matériaux, de configuration, de format
mais avec une égalité de présence, de rayonnement.
Je dirais également qu’il y a des proximités entre pièces d’un même moment
mais pas vraiment de séries, en un sens strict.
En tout cas il s’agit là d’un travail qui n’est pas un travail de la répétition
et d’un travail qui n’est pas non plus à proprement parler
un travail de la variation.
Je le vois plutôt comme une sorte de pratique du glissement.
J’avais en tête ce titre de Robbe-Grillet :
Glissements progressifs du plaisir.
Le plaisir n’est sans doute pas la question centrale ici
mais, en tout cas : des glissements, glissement progressif,
de pièce en pièce.
Tout travail est fait d’une certaine dialectique
ou d’un certain mixte de continuité et de rupture
avec une polarisation plus ou moins affirmée
vers l’un ou l’autre des termes.
Dans le cas du travail de Rachel nous sommes confrontés
au fil du temps, à des choses extrêmement hétérogènes
mais qui ne relèvent pas pour autant d’une logique de rupture.
Je ne sais pas vraiment comment Rachel procède dans l’atelier
mais j’ai l’impression d’un travail assez déductif, comme si
chaque nouvelle pièce était l’occasion d’un point,
d’une reprise et réorientation.
Et glissement est le terme qui me paraît le plus juste
pour nommer ce feuilletage entre le même et le neuf.
Depuis le début de mon intervention
vous aurez peut-être remarqué que je dis « pièces », « objets »
je ne dis pas « sculptures ».
Au-delà du constat trivial de la tridimensionnalité
je ne suis pas sûr que « sculpture » soit le terme le plus adapté
pour nommer la pratique de Rachel, ce n’est en tout cas
pas une évidence pour moi.
Et je ne dis pas cela comme une provocation.
L’idée n’est pas de dire qu’il s’agirait plus ici d’installation
ou de peinture ou de je ne sais quelle dénomination.
Mais plutôt qu’il s’agit peut-être ici de quelque chose
qui résiste au classificatoire, à la nomination tranchée.
Qu’il s’agit d’une indécision de la nomination.
Cette indécision de la nomination du travail dans son ensemble,
de l’œuvre rapportée à un « champ » ou un genre
contraste avec la grande précision matérielle avec laquelle
est titrée chaque pièce rapportée à son matériau constituant
et à ses dimensions.
Je renvoie à la nomenclature détaillée qui se trouve à la fin
du petit catalogue.
Face aux pièces de Rachel, constatant cette indécision,
j’ai songé à un autre titre : Défaire le genre,
qui est le titre d’un livre de Judith Butler
mais genre ne se rapportant évidemment pas ici aux « gender studies »
mais plutôt à une certaine manière,
venue du romantisme allemand, celui de Iéna,
des frères Schlegel, de Novalis,
une certaine manière donc
d’inquiéter les limites entre genres,
de perturber la raison classificatoire.
Alors, si on tenait vraiment à nommer les choses,
je proposerai de parler d’ « objets spécifiques »
en reprenant l’expression de Donald Judd
dans un tout autre contexte et pour désigner
une toute autre réalité.
Une dernière intuition pour conclure en ouvrant.
Juste une intuition, donc quelque chose que je ne serai
pas en état de démontrer aujourd’hui, une intuition qui
je crois n’est sans proximité avec le texte d’Agnieszka Tarasiuk
inclus dans ce petit catalogue. Elle nous dira si cela résonne pour elle.
L’intuition est donc la suivante : le travail de Rachel, du côté du geste,
— chaque « pièce » est une cristallisation de gestes —
et instituant une durée propre, une concentration de temps
me semble se présenter dans une plus grande proximité
à l’anthropologie qu’à l’histoire de l’art.
Bénédicte Duvernay
Pas d'agencement nécessaire
Nous avons pris comme point de départ pour notre intervention une phrase de Rachel Poignant dans un entretien avec Anka Ptazkowska en 1998. L’entretien a eu lieu juste avant une exposition, et Anka demande à Rachel ce qui la gêne dans le fait d’exposer son travail. Rachel répond :
« Tout bêtement le fait que cette situation n’est pas naturelle, le fait de choisir aussi.
Dans l’atelier, je ne choisis pas la place de l’objet. L’exposition induit un agencement de l’espace et je sais qu’il n’y a pas d’agencement nécessaire. (…) le choix me fait perdre la liberté de mouvement. »
Ce problème du choix, RP le rencontre dans l’accrochage de ses pièces, mais aussi dans la pratique même de la sculpture. Elle a commencé son travail de sculptrice à l’école des beaux-arts de Caen, dans les années 1990 où, pour contourner ce problème du choix et de la décision initiale, elle moulait des objets eux-mêmes fabriqués en série, puis refaisait des moulages des pièces obtenues. C’est ce qu’on peut voir sur les photographies accrochées dans la première salle de l’exposition, en particulier les petites chaises d’enfants;

La première chose que je voudrais souligner à ce sujet est qu’en parlant avec RP, j’ai compris que c’était surtout l’idée de « projet » qui la dérangeait, dans sa pratique d’artiste. Il me semble qu’il y a dans cette attitude quelque chose de l’ordre d’une résistance, tant il est vrai que le terme – entrepreneurial – de « projet » tend à s’imposer dans tous les domaines de la vie sociale, y compris les écoles d’art.
Cette préoccupation de RP – l’idée qu’il n’y a pas d’agencement nécessaire, que les pièces peuvent toujours être refaites et toujours être disposées différemment – résonne par antithèse avec l’histoire des problèmes posés par les avant-gardes européennes dans les premières décennies du XXe siècle, en particulier lorsqu’il s’agissait de réfléchir aux bases nouvelles sur lesquelles fonder la sculpture moderne.
En disant qu’il n’y a pas d’agencement nécessaire en sculpture, elle s’inscrit, a priori, aux antipodes de la sculpture constructiviste russe, dont le problème était d’éviter l’arbitraire de la composition, en trouvant une motivation régissant l’agencement des parties de l’œuvre de manière objective. C’est le cas chez Karl Ioganson, par exemple, qui met en œuvre les lois physiques de la tenségrité
En ce qui concerne le constructivisme polonais, non productiviste, on peut citer l’exemple de Katarzyna Kobro, qui s’intéressait non pas à la physique mais aux mathématiques, notamment à Pythagore et à la suite de Fibonacci, qu’elle a utilisée à des fins d’agencement spatial. Pour ces artistes, l’idée de structure est essentielle.
La comparaison de l’œuvre à un organisme était un autre moyen de justifier le fait que, pour ces artistes, la sculpture était désormais fondée sur des lois d’agencement objectives. Elle est omniprésente chez Naum Gabo, par exemple, mais on la trouve aussi chez le peintre polonais Strzemiński qui énonce la chose suivante :
« Je définis l’art comme la création de l’unité de formes dont l’organicité est parallèle à celle de la nature ».
J’ajoute que Naum Gabo, qui a étudié à Munich les sciences naturelles et les mathématiques, s’intéressait de près à l’ossature des corps humains et animaux.
RP pour sa part travaille aux antipodes du modèle de complétude organique associée à l’idée de structure. Dans des moulages réalisés il y a une dizaine d’années, elle fait même jouer les petits accidents de la chimie contre les lois physiques de stabilité : le polyuréthane, en s’expansant de manière plus ou moins contrôlée par l’artiste, fait craqueler le moule en terre qui l’emprisonne.

Les constructivistes considéraient leurs pièces comme « organiques » - et les légitimaient ainsi - par analogie avec la complétude structurelle des organismes visibles dans la nature. L’« organique » avec lequel a affaire RP, au début de son parcours de sculptrice (dans la première salle de l’exposition), n’est pas du tout du côté de la structure. Il naît des matières qu’elle travaille et des formes qu’elle obtient, dont beaucoup peuvent faire penser à des morceaux de corps, à des morceaux de bois, etc.

RP dit avoir été gênée par ces connotations trop évidemment organiques, et il y a une évolution très nette de son travail que l’exposition fait apparaître. À un certain moment de son parcours, elle cesse d’utiliser la paraffine comme matériau directement sculpté, pour en faire un usage « négatif », c’est-à-dire l’utiliser comme moule permettant d’obtenir les plaques et les grilles en résine acrylique
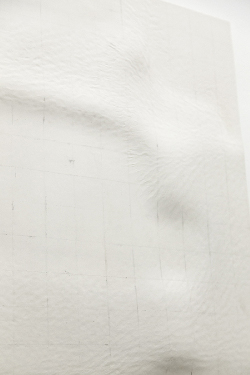
Selon ses propres termes, cela permettait de mettre à distance les connotations trop directement, trop évidemment corporelles de la paraffine et de la mousse en latex, pour ne plus garder que l’empreinte de ces matières souples sur un matériau qui se rigidifie, la résine acrylique. Dans l’exposition, cette évolution est bien visible, et s’accompagne d’un changement de leur disposition dans l’espace

Le mouvement de l’exposition est donc celui-ci : on commence avec des objets à connotation organique très forte, réalisés dans des matériaux périssables et posés pêle-mêle sur un socle dans la première salle, de façon très dense. Puis les pièces s’aplatissent, elles sont plus légères et plus aérées, en même temps qu’elles s’élèvent dans la salle et gagnent les murs.

Cette photo de l’exposition au Brésil est très intéressante parce qu’elle montre le moment où RP introduit ces tables construites par elle qui vont permettre d’élever les pièces.
La problématique organique, corporelle qui intéresse RP depuis le départ (elle a commencé à sa sortie de l’école des beaux-arts en faisant des moulages de son propre corps) trouve donc une nouvelle manière d’exister dans son travail au moment où l’artiste introduit une tension entre une matière molle et une structuration géométrique sous la forme des grilles, des trames. C’est à mon avis une manière très intéressante de réintégrer dans ce travail, qui part des expériences post-minimales de la sculpture, la tendance architecturale et constructive de la sculpture d’avant-garde, délestée de son fondement utopiste et rationaliste. Il n’y a pas d’agencement nécessaire chez RP, d’accord, mais ce qui est intéressant est que cette posture, qui intègre tout ce qu’il y a d’aléatoire, d’informe, de mou, de périssable, de non-fini dans la sculpture (dans l’art en général) à partir des années 1960 travaille avec – c’est-à-dire à la fois en l’intégrant et en la dépassant – la forte architecture des pièces de la sculpture moderne
La question de l’ossature, si importante pour le constructivisme, est mise en tension chez RP avec les délicates vibrations, les plis de la résine acrylique qui forme une « peau » dans beaucoup des pièces exposées sur les murs de l’exposition
La dimension structurelle de la sculpture moderne est assimilée non pas en tant que telle, non pas en tant que citation non plus, mais dans une tension avec ce qui est le travail de RP au départ. Il semblerait que RP ait intégré dans son travail une contrainte qui fait ressortir plus vivement encore ce qui l’intéresse dès le départ, c’est-à-dire le rapport entre corps et sculpture. Il est même possible que cette contrainte ait été introduite dans la pratique même : nous n’avons pas eu le temps d’en discuter beaucoup, mais j’ai cru comprendre que la période des mousse-latex et des paraffines correspondait à un travail intense, de 8h par jour, à une sorte de production continue. Est-ce que la respiration introduite dans les pièces correspond à une respiration dans la pratique elle-même ?

Adrien Malcor
Pas d’agencement nécessaire (2/2)
... tout ce qui est de nous nous quitte, comme la chaleur d’un plat très chaud.
R. M. Rilke, Élégies de Duino
Dans le tandem que nous formons aujourd’hui avec Bénédicte, je suis chargé d’un épilogue spéculatif et rétrospectif. Rétrospectif parce que je vais surtout utiliser un entretien vieux de vingt ans (1998) entre l’artiste et Anka Ptaszkowska, et donc évoquer les premières années du travail. Je m’y sens autorisé par ce besoin que Rachel Poignant nous confiait récemment de « partir du début ».
Je rappelle la déclaration de l’artiste qui nous donne notre titre. « Qu’est-ce qui te gêne dans le fait d’exposer ton travail ? », lui demandait Anka ; ce à quoi Rachel répondait :
Tout bêtement le fait que cette situation n’est pas naturelle, le fait de choisir aussi. Dans l’atelier, je ne choisis pas la place de l’objet. L’exposition induit un agencement de l’espace et je sais qu’il n’y a pas d’agencement nécessaire. En même temps, le choix me fait perdre la liberté de mouvement1.
Je partirai du fait simple que Rachel associe situation « naturelle » et agencement « nécessaire » ; le glissement des adjectifs est justifié dans la langue (française), il l’est aussi dans l’histoire de l’idée savante de nature, qui implique la notion de « loi » (les lois de la nature). En philosophie, on oppose la nécessité non pas au hasard mais à la contingence : « il n’y a pas d’agencement nécessaire », c’est-à-dire « tous les agencements sont contingents ». Sauf réarticulation conceptuelle en profondeur, comme chez Spinoza, la nécessité s’oppose aussi à la liberté, au libre arbitre ; la liberté suppose une ou des contingences.
Et je chercherai donc, assez scolairement au fond, à réarticuler la « liberté de mouvement » revendiquée par Rachel en 1998 non pas sur la recherche d’une nécessité mais bien sur ce savoir intime de la contingence, qui – c’est notre thèse – nourrit ou contamine son activité artistique bien en amont de la situation d’exposition. J’interroge assez directement la lecture « ascétique » d’Anka, qui cherche la « nécessité » du travail de Rachel Poignant du côté d’une « obéissance » aux « lois de la matière », obéissance qui détermine un « destin ». Anka n’étant pas avec nous, je n’y insisterai pas. Mais je vais avoir recours à l’une des nombreuses constructions philosophiques appuyées sur la notion classique de « loi naturelle », notion où, comme le dit Jean Ehrard, la raison et la foi – c’est-à-dire aux xviie et xviiie siècles la physique mathématisée et la théologie – ont pu un temps trouver un « équilibre provisoire2 » (on attribuait alors un rôle à Dieu dans l’instauration voire l’application des lois naturelles).
Ce sera, chez Sade, qui comme on sait a écrit dans le paysage philosophique des Lumières, le discours du pape Braschi, dans l’Histoire de Juliette, publiée en 1800. Construction tardive, donc, dans les Lumières, et hétérodoxe, vous allez voir en quoi. J’entre vite en matière, et je passe le contexte romanesque : il nous suffit de savoir que Sade fait de Jean-Ange Braschi alias Pie VI un épouvantable libertin, et donc un philosophe. Je vais rapprocher quelques extraits de ce discours (de ses prémisses, en fait) de certaines déclarations de Rachel en 1998. Je commenterai des convergences ou des coïncidences, pas toutes, aussi je vous demande d’ouvrir une oreille analogique.
Voici donc ce que dit le pape Braschi – rien de moins que la vérité, infaillibilité papale oblige :
Aucun être ici-bas, n’est exprès formé par la nature, aucun n’est fait à dessein par elle ; tous sont les résultats de ses lois et de ses opérations, en telle sorte que, dans un monde construit comme le nôtre, il devait nécessairement y avoir des créatures comme celles que nous y voyons ; de même qu’il en est sans doute de très différents dans un autre globe... dans cette fourmilière de globes, dont l’espace est rempli ; mais, ces créatures ne sont ni bonnes, ni belles, ni précieuses, ni créées ; elles sont l’écume, elles sont le résultat des lois aveugles de la nature, elles sont comme les vapeurs qui s’élèvent de la liqueur raréfiée dans un vase par le feu, dont l’action chasse de l’eau les parties d’air que cette eau contient. Elle n’est pas créée cette vapeur, elle est résultative, elle est hétérogène, tire son existence d’un élément étranger, et n’a par elle-même aucun prix, elle peut être, ou ne pas être, sans que l’élément dont elle émane en souffre ; elle ne doit rien à cet élément et cet élément ne lui doit rien. Qu’une autre vibration différente de celle de la chaleur, vienne modifier cet élément, il existera toujours sous sa nouvelle modification, et cette vapeur, qui devenait son résultat sous la première, ne le sera plus sous la seconde. Que la nature se trouve soumise à d’autres lois, ces créatures qui résultent des lois actuelles, n’existeront plus sous les lois nouvelles, et la nature existera pourtant toujours, quoique par des lois différentes3.
Je commente le plus vite possible : voyez comment Braschi commence par récuser la finalité – le projet, dirait Rachel – au nom d’une nécessité causale (les lois de la nature font que telle cause entraîne tel effet), puis récuse cette nécessité causale au nom d’une contingence modale, au nom de la contingence des lois elles-mêmes (les lois pourraient être différentes). L’idée d’une contingence des lois naturelles n’est pas une invention de Sade, c’est une hypothèse décisive des Lumières, qu’elles héritèrent en particulier de Leibniz : Braschi la donne d’ailleurs dans sa gangue classique, la théorie des mondes possibles, mêlée ici au thème plus ancien de la pluralité des mondes4. Mais il s’en sert, non pas comme Maupertuis un demi-siècle plus tôt pour prouver la cohésion interne des lois de Newton et par là désarrimer métaphysique et physique (geste historique !), mais bien pour détruire je dirais pour de bon l’unité multiséculaire d’un concept de nature comme principe d’ordre, plus ou moins compatible avec l’action plus ou moins lointaine d’un Créateur divin sous quelque forme que ce soit 5. Comprenez que j’essaie ici d’acter le rejet par Rachel des métaphysiques traditionnelles de la « création » artistique, et même de tirer ses positions « agnostiques » (quant aux « causes premières » de son activité) vers des zones plus franchement athées.
Le corollaire, chez Braschi, de cette contingence métaphysique, c’est cette indépendance, cette indifférence entre une nature naturante, qui bien que personnifiée n’a rien du Créateur infiniment sage, et une nature naturée ou « résultative », appelée plus loin « l’empire des trois règnes » (minéral, végétal, animal). Les créatures ne sont pas autonomes (littéralement, elles ne se donnent pas à elles-mêmes leurs propres lois), mais bien indépendantes – de la nature6. Je crois qu’on vérifie subjectivement cette hétérogénéité, cette « étrangeté réciproque » entre l’artiste et ses pièces – car c’est de ça que je parle, et je reprends la formule à Anka7 – au fait que Rachel peut tout à fait dire que telle de ses pièces est magnifique sans qu’on éprouve le moins du monde le sentiment qu’elle se vante !
Autre corollaire, toute hiérarchie des êtres est annulée : « sera-ce aux yeux de la nature, qui lance indifféremment tous ces jets, que l’une ou l’autre production de ces jets pourra devenir plus chère8 ? » Non point, et d’abord parce que le jet n’est pas le projet9. Et je cite maintenant une suite de trois déclarations de l’artiste en 1998 :
J’ai un rapport très affectif à mon travail. Chaque objet a son importance et en cela je les place à égalité. Il n’y en a pas un qui vaille plus qu’un autre. C’est là où j’arrive, peut-être, à avoir une certaine distance par rapport à mes pièces. [...] Les pièces sont fragiles aussi, elles se cassent parfois, mais je n’en fais pas un drame. J’en ferai d’autres. Je n’ai pas de rapport de valeur aux objets. Les pièces sont comme des morceaux. [...] Il faut rappeler la facilité avec laquelle je m’en détache ; je peux très vite les casser ou les refondre. Même si je perds une pièce je ne perds pas le travail10.
Où l’on touche au degré zéro du « principe d’égalité » cher à Anka. Chaque pièce ici compte non pas pour une, mais pour zéro11, remplaçable qu’elle est dans le processus. Zéro égale zéro : elle peut être, être autre ou ne pas être – stricte définition de la contingence. Les pièces sont égales devant leur périssabilité, périssabilité dont Rachel fait explicitement une problématique de son travail, au même titre que l’« élimination » et le « recyclage »12.
Car détruire ou éliminer, chez Rachel, c’est ou c’était souvent recycler. Or, qu’il n’y ait jamais destruction mais recyclage, c’est la loi de la nature qu’on invoque le plus volontiers chez Sade (le chimiste Lavoisier lance à l’époque son « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »). Ce n’est pas, pour un libertin supérieur comme Braschi, une loi de la nature, mais la première loi des règnes : « une métempsychose perpétuelle, une variation, une mutation perpétuelle entre eux 13 ». Je le cite encore :
Il n’y a enfin nulle différence essentielle entre cette première vie que nous recevons, et cette seconde que nous appelons mort. Car la première se fait par la formation de la matière, qui s’organise dans la matrice de la femelle ; et la seconde est, de même, de la matière qui se renouvelle et se réorganise dans les entrailles de la terre. Ainsi, cette matière éteinte redevient elle-même, dans sa nouvelle matrice, le germe des particules de matière éthérée, qui seraient restées dans leur apparente inertie, sans elle ; et voilà toute la science des lois de ces trois règnes, lois indépendantes de la nature, lois qu’ils ont reçues, dès leur premier échappement, lois qui contraignent la volonté qu’aurait cette nature de produire de nouveaux jets ; voilà les seuls moyens par lesquels s’opèrent les lois inhérentes à ces règnes. La première génération, que nous appelons vie, nous est une espèce d’exemple : ces lois ne parviennent à cette première génération, que par l’épuisement ; elles ne parviennent à l’autre que par la destruction. Il faut à la première, une espèce de matière corrompue, à la seconde de la matière putréfiée ; et voilà la seule cause de cette immensité de créations successives, elles ne sont dans les unes et dans les autres que ces premiers principes d’épuisement ou d’anéantissement [...] 14.
Vous aurez relevé l’image des deux « matrices », avec cette équivalence vie/mort portée par l’image prémoderne, mythique, des entrailles de la terre (comme utérus). Je note au passage qu’il est parfois difficile de rattacher en imagination les objets de Rachel – je pense à certains de ceux de la première salle – à l’un ou l’autre des trois règnes (minéral, végétal ou animal) ; le processus de « corruption » matérielle (parrafine ou mousses latex recyclées, teintées...), mis au service de la confusion des règnes, place son travail sous le signe d’une tératologie subtile, dont Bénédicte a évoqué certains aspects.
Je rebondis enfin sur les « principes d’épuisement ». Le mot « épuisement » est l’un des premiers prononcés dans l’entretien de 1998, et Rachel déclare alors :
Au moment de l’épuisement il y a aussi le début de quelque chose, des amorces de formes, d’idées qui apparaissent et le même travail se reporte sur une forme différente. C’était un processus extrêmement linéaire ; pendant deux ans [1990-1992] j’ai vraiment fait la même chose, je m’appuyais sur un processus de type : des moulages, des moulages, des moulages. Il y avait aussi un épuisement mental, un manque de croyance15.
L’artiste, si j’ai bien compris les précisions qu’elle nous a faites à ce sujet, mettait à profit ces moments d’épuisement – états limites, qui interrompent le processus de moulage de moulage (MDM) – pour considérer les formes à l’arrêt : une « stratégie », nous a-t-elle dit, pour repousser le choix16. Un bon vitaliste applaudirait – un peu cruellement d’ailleurs – à cette ruse physiologique17. Dans la perspective sadienne qui est aujourd’hui la mienne, je dirais bien plutôt que cet épuisement est d’abord et avant tout le signe, presque la preuve expérimentale de ce que Braschi nomme « hétérogénéité » : la forme est détachée des forces (et des espoirs) de la sculptrice (elle en vient, mais s’en sépare) ; la linéarité du processus n’est qu’une nécessité résultative, qui encombre l’atelier et frustre l’artiste.
Mais observez donc qu’elle n’est pas maîtresse, qu’elle est la première esclave de ses lois... qu’elle est enchaînée par ses lois, qu’elle n’y peut rien changer, qu’une de ses lois est l’élan des créatures une fois fait, et la possibilité à ces créatures lancées de se propager. Mais que si les créatures ne se propageaient plus, ou se détruisaient, la nature rentrerait alors dans de premiers droits qui ne seraient plus combattus par rien, au lieu qu’en propageant ou en ne détruisant pas, nous la lions à ses lois secondaires, et la privons de sa plus active puissance18.
J’ai redonné, vous l’avez compris, la parole à Braschi. C’est bien au nom des « premiers droits » de cette nature, de « sa plus active puissance », qu’il peut associer les « créations successives » à un « principe d’épuisement ». L’épuisement est une épiphanie de la contingence, qui pourrait avoir sa face lumineuse. En effet, la paraffine semble avoir conféré à l’artiste cette liberté dont la nature de Braschi est privée. Avec la paraffine, dit Rachel :
Il y a d’abord la possibilité de pouvoir faire et refaire jusqu’à ce qu’il n’en reste que quelques éléments. Je pense que je peux évacuer beaucoup de choses, je peux même faire tout et n’importe quoi, et ensuite enlever. Je m’offre alors la liberté de pouvoir faire sans être encombrée par ce faire. Je fais, mais ça disparaît19.
Cette « liberté de pouvoir faire sans être encombrée par ce faire », c’est précisément celle qui manque à la nature, dont les « faire » ne sont pas créations, je le rappelle, mais – je cite les mots de Braschi – « jets », « lancers » 20, « élans », « échappements » : elle voudrait comme Rachel « faire tout et n’importe quoi, et ensuite enlever »... pour refaire. « Je fais, mais ça disparaît », dit l’artiste, quand la nature « désirait l’anéantissement total des créatures lancées, afin de jouir de la capacité qu’elle a d’en relancer de nouvelles21 ».
Je quitte là le pape Braschi, avant que sa solution (le crime) ne diverge trop nettement de celle de Rachel (l’art – et par l’art, je dirais, le plaisir de la surprise joint à la surprise du plaisir) 22. Que déduire, alors, de ces quelques coïncidences ? Il serait abusif d’affirmer que l’artiste Rachel Poignant crée comme cette « mère aveugle » sadienne : ce serait faire peu de cas du soin, du sens de l’observation, du savoir-faire aussi, qui, quoi qu’elle puisse dire, permettent sans doute à Rachel de canaliser, de catalyser les opérations techniques vers la sculpture. Je ne pense pas non plus que Rachel envisage d’un bon œil l’anéantissement total de sa production, et on sait qu’elle évite désormais les matériaux les plus périssables. La nature inspire-t-elle à l’artiste un grand fantasme de recommencement ? Rachel a connu de « nouveaux départs » : changements d’atelier, résidences, voyages. Il y a quelques années (2015), elle disait avoir fait au Brésil l’« expérience du vide du recommencement23 ». Mais elle rappelait alors que cette possibilité de repartir de zéro se présente à elle chaque matin à l’atelier, et, commentant son travail, elle revient plus souvent sur ces deux années de MDM comme à l’expérience fondatrice dont elle dit avoir à « témoigner ». Et elle en parle aussi et de plus en plus souvent comme d’une expérience du plaisir, celle d’un espace-temps plein voire saturé où, selon ces mots, il n’y a « pas d’espace entre les choses », où les choses « collent », où « tout se touche » et « sans arrêt »24.
Aussi verrais-je, derrière ce besoin déclaré de « partir du début », celui moins d’un récit rétrospectif que d’une activité-passivité inchoative (et non « résultative »), soit la recherche non pas tant du point d’origine temporelle que du plan de contact, de la membrane le long de laquelle la « liberté de mouvement » de l’artiste (sa pensée ?) viendrait se confondre avec la « fluidité » du matériau25. Et sans doute est-ce encore trop dire. Si la destruction est bien à l’horizon de cette expérience, c’est peut-être en tant qu’elle reconduit et accélère idéalement (intensivement) ce jeu de la déprise et de la surprise, et ce jusqu’à, je dirais, la température de fusion entre sujet et objet. La grande soif chez Rachel Poignant de plaisir haptique (« L’œil est collé, le regard glisse26 ») n’en serait alors qu’une manifestation communicable, de même que sa pratique du « recyclage » ne serait que la forme la plus visible ou l’alibi pratique de son étrange compulsion de réabsorption27.
J’ai bien conscience de postuler une expérience limite, et même un franchissement voire un affranchissement des limites (matérielles, temporelles, existentielles...) par lesquelles l’activité de Rachel est viable et productive. Il me suffit que l’artiste en reconnaisse l’appel souterrain, la « tentation » nous disait-elle28. Admettons avec Braschi que cette tentation est bien l’appel de la nature, de cette nature brouillonne, indifférente et infanticide, qui pourrait devenir dangereusement familière aux humains du xxie siècle. On pourrait alors lui imputer les résonances postapocalyptiques relevées par Agnieszka Tarasiuk29, ce que j’appellerais le côté Pompéi de cette œuvre, à la condition expresse de garder à l’esprit ce fait que Rachel Poignant ne travaille pas, comme disent les philosophes, sous horizon de monde (fût-il celui de la fin)30.
Mais je conclus sur la liberté, en rappelant, dans le sillage d’une relecture récente du discours de Braschi (par Pierre-Henri Castel en 2014), combien cette nature est proche de celle de Lucrèce, des épicuriens. L’hypothèse est diversement motivée chez Castel : disons que la pensée et l’art sadiens des « gradations » (de mal en pire) pourrait s’avérer une version perverse – mais non pervertie – des doctrines antiques de l’atomisme moral telles qu’appuyées sur la fameuse notion de clinamen. Pour rappel, le clinamen est, dans l’univers de Lucrèce (qui n’est pas un cosmos), cette infime déviation dans la chute des atomes, qui non seulement rend possible leurs agrégations et désagrégations mais inscrit ou signifie dans la physique la marge de liberté qui nous permet, à nous les humains, de chercher et de trouver notre bonheur. Or, tout comme l’éducation de Juliette, l’activité de Rachel Poignant « procède sur un mode d’amplification successive des “écarts” auxquels elle peut, et même doit se livrer pour augmenter son bonheur (sa jouissance)31 ». L’artiste serait à l’écoute, elle aussi, de « cette libre volupté épicurienne, qui est un mouvement de déviation entraînante – et la voix de la Nature32 ». Car le clinamen est bien cet écart par lequel tout se touche33, et vous m’accorderez qu’il fait une jolie constellation des principaux mots clés avancés par l’artiste au plus près du concret de sa pratique : « écart », « glissement » et « déviation » bien sûr, « transformation » aussi peut-être, et j’ajoute les références régulières de l’artiste à l’inframince duchampien.
1Entretien avec Anka Ptaszkowska, disponible sur le site de l’artiste : http://rachel-poignant.com/textes/31-entretien-realise-en-1998-dans-l-atelier-de-l-artiste.
2Jean Ehrard, L’Idée de nature en France dans la première moitié du xviiie siècle (1963), Paris, Albin Michel, 1994
3Donatien Alphonse François de Sade, Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice (1800), dans Œuvres, éd. Michel Delon, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. III, 1998, p. 870-871.
4Sur cette idée et son histoire, voir André Charrak, Contingence et nécessité des lois de la nature au xviiie siècle. La philosophie seconde des Lumières, Paris, Vrin, 2006.
5Car « dès le départ [chez les Anciens] une notion de finalité est associée dans celle de nature à celle de nécessité » (J. Ehrard, L’Idée de nature..., op. cit., p. XXX.).
6Cette distinction utile a été faite par XXX.
7Entretien avec A. P., 2002, inédit.
8Histoire de Juliette, op. cit., p. 878.
9Je signale que le mot « jet » appartient au vocabulaire spontané de Rachel Poignant, qui parle volontiers, en matière d’accrochage, de « premier jet », « deuxième jet »...
10Entretien avec A. P., 1998, op. cit., p. XXX.
11Ou entre zéro et un : « morceaux ».
12Entretien avec A. P., 2006, inédit.
13Histoire de Juliette, op. cit., p. 873. Les règnes « se reproduisent et se détruisent machinalement tous les trois, parce que tous trois sont composés des mêmes éléments, qui tantôt se combine d’une façon, tantôt d’une autre [...] » (ibid.). Voir infra sur le néo-épicurisme de Sade.
14Ibid., p. 874. Quelques pages plus loin, l’idée est reprise dans une note de Sade, qu’il dit inspirée de ou empruntée à Voltaire, et où il réimporte ironiquement le vocabulaire chrétien (« miracle », « résurrection ») délaissé par le pape : « Il faut appeler régénération, ou plutôt transformation, ce changement que nous voyons dans la matière ; elle n’est ni perdue, ni gâtée, ni corrompue, par les différentes formes qu’elle prend, et peut-être une des principales causes de sa force, ou de sa vigueur, consiste-t-elle dans les apparentes destructions qui la subtilisent, lui donnent plus de liberté, pour former de nouveaux miracles ; la matière, en un mot, ne se détruit point pour changer de formes, et prendre une nouvelle modification ; de même, dit Voltaire (dont cette note est extraite), qu’un carré de cire qu’on réduit en rond, ne périclite point en changeant de figure : rien de plus simple que ces résurrections perpétuelles ; et il n’est pas surprenant de naître deux fois qu’une ; tout est résurrection dans la nature ; les chenilles ressuscitent en papillons ; un noyau que l’on plante ressuscite en arbre ; tous les animaux ensevelis dans la terre ressuscitent en herbe, en plante, en vers, et nourrissent d’autres animaux, dont ils font bientôt une partie de la substance, etc., etc., etc. » (ibid., p. 881).
15Entretien avec A. P., 1998, op. cit.
16Conversation du 1er janvier 2018.
17L’épuisement mental ne serait alors qu’un effet secondaire de cette ténacité vitale, ou tout simplement la réaction louable d’une artiste honnête voyant par moments son processus dégénérer en procédé (perdre son sens, sa « nécessité »). L’artiste nous précise que cette perte de croyance tient aussi au processus de dégradation formelle impliqué par les MDM.
18Histoire de Juliette, op. cit., p. 872.
19Entretien avec A. P., 1998, op. cit. Rachel semble ensuite accorder à Anka que ce faire désencombré participe d’une « recherche d’économie » (même si « parler d’économie peut sembler bizarre »). Cela contredirait a priori mon interprétation, qui réfère ce destructionnisme à quelque principe naturel d’excès. Mais Braschi lui-même a soin de noter que, si la nature ne détruit pas immédiatement ses encombrantes créatures, ce n’est pas qu’elle ne le peut pas, mais parce qu’« elle ne fait jamais rien d’inutile » (Histoire de Juliette, op. cit., p. 872). Humour de l’auteur mis à part, la nature de Braschi n’est pas tout à fait encore l’univers bataillien de la « dépense ».
20Coups de dés ?
21Histoire de Juliette, op. cit., p. 873.
22J’espère pouvoir un jour puiser dans les entretiens inédits de quoi compléter le tableau à deux colonnes où le « je » de Rachel, d’un côté, ferait écho au « elle » de la nature selon Braschi. Ce tableau – le « Braschel » – pourrait faire un peu peur, quand bien même, là où était ce « elle », aucun « je » ne pourrait jamais advenir.
23Entretien avec A. P., 2015, inédit.
24Je mêle ici des expressions de l’artiste.
25Voir entretien avec A. P., XXX.
26Entretien avec A. P., 1998, op. cit. L’artiste parle de son « rapport hypnotique à l’objet ».
27J’en veux pour preuve le fait que l’artiste juge défavorablement les pièces dont les caractéristiques empêchent le retour dans le processus de moulage (par exemple ses grandes « axonométries » de 20XX). Elle affirmait il y a quelques années que le recyclage était pour elle moins une technique qu’une pensée (entretien avec A. P., 2015, inédit).
28Conversation du 1er janvier 2018.
29Voir Rachel Poignant, Générations, livret, p. XXX.
30Elle nous l’a confirmé : si elle accepte volontiers les associations des regardeurs (s’en « amuse »), elle se retient de donner une cohérence figurative à un ensemble de pièces, et donc de faire monde : ce serait, dit-elle très logiquement, se redonner un « système » (conversation du 1er janvier 2018). Le constat de cette incomplétude figurative est en fait le point de départ de notre propre approche ; et la nature n’est pas le monde.
31Sade à Rome, op. cit., p. 128.
32Ibid., p. 12X.
33Au sein d’une doctrine épicurienne qui conduit à penser la communication homme-nature (et le plaisir de l’instant) sous les espèces de la sensation par contact. Voir sur ce point les pages dédiées aux épicuriens et à Lucrèce dans l’« Histoire de la notion d’individu » de Gilbert Simondon (reprise dans L’Individuation à la lumière des notions de forme et d’information, ). Ce n’est qu’après un tel détour que je me permettrais quant à moi de convoquer le texte philosophique qui ne peut pas ne pas venir à l’esprit des amateurs de philo devant le travail de Rachel Poignant, je veux parler de l’étude magistrale, par le même Simondon, du moulage de la brique, qui inaugure sa critique du schéma hylémorphique (voir ibid., p. 39 sq.).